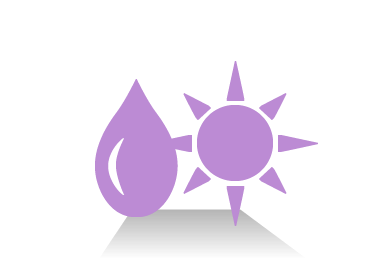L'impact environnemental des datacenters : un pari perdu d'avance ?
 Exaion
ExaionClassés « électro-intensifs », les datacenters ont amélioré leur efficacité énergétique ces vingt dernières années. Mais alors que les services numériques ne cessent de se développer, le secteur doit relever le défi, plus large, de son impact environnemental.
La hausse des prix des énergies frappe durement les opérateurs de datacenters en France. Ces sites sont gourmands en kilowattheures pour faire tourner leurs serveurs informatiques, mais aussi leurs systèmes de refroidissement indispensables au bon fonctionnement de ces installations. En réponse au plan national de sobriété énergétique, France Datacenter a proposé de limiter début octobre le recours à la climatisation dans les centres de données, « si l’infrastructure le permet ». Selon cette association représentant les acteurs économiques de la filière, le passage de 21 à 23°C diminuerait la consommation d’énergie de l’ordre de 7 à 10 %. Une manière aussi de réduire la facture de ces installations électro-intensives. Certes, la profession bénéficie du mécanisme d’accès réglementé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) permettant d’acheter à EDF une certaine quantité d’électricité nucléaire à prix fixe. Mais ce tarif doit augmenter de 15 % l’année prochaine…
En janvier 2022, la France comptait 264 datacenters selon le portail Statista, un chiffre qui ne comprend pas les salles informatiques propres aux administrations et aux entreprises. Le contexte de flambée des cours des énergies, mais aussi des matières premières incite plus que jamais leurs exploitants à se pencher sur leur efficacité énergétique. « La filière planche sur le sujet depuis plusieurs années, comme en témoigne le Livret des bonnes pratiques environnementales publié par France Datacenter. Par ailleurs, la consommation électrique des datacenters a plutôt tendance à se stabiliser malgré l’accroissement du nombre de serveurs. C’est le résultat de l’amélioration des performances des systèmes informatiques et des efforts des hébergeurs », insiste Géraldine Camara, déléguée générale de France Datacenter.
Inauguré le 6 octobre, le dixième centre de données francilien de l’américain Equinix incarne cette révolution vertueuse : la chaleur produite par le système de refroidissement de ses 5 500 m² sera réinjectée dans le réseau de chauffage urbain de la ville de Saint-Denis, permettant d’alimenter l’équivalent de 1 600 logements. Mais d’autres projets, aux proportions gigantesques inquiètent. Ainsi, CloudHQ, un autre fournisseur américain, compte mettre en service dans les années à venir dans l’Essonne l’une des plus grosses infrastructures françaises. Ses 48 salles informatiques (66 000 m²) nécessiteront 114 groupes électrogènes et 36 cuves de fioul… Pour inciter les exploitants de ces usines informatiques à améliorer leur bilan électrique, la question des indicateurs est primordiale. Le PUE (power usage effectiveness) est le premier paramètre mis en place par le secteur. Celui-ci mesure le ratio entre l’énergie totale consommée par les centres de données et l’énergie nécessaire au fonctionnement de ses équipements informatiques.
2 à 3 % de l’électricité mondiale
Les datacenters représentent 2 à 3 % de l’électricité consommée dans le monde et 0,4 à 0,75 % des émissions de CO2, selon le consortium international Uptime Institute. En France, un récent rapport de l’Ademe et de l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) estime que le numérique est responsable de 2,5 % de l’empreinte carbone de la France et de 10 % de sa consommation électrique. Le document précise que les datacenters génèrent 4 à 20 % des impacts environnementaux, devant les réseaux (de 4 à 13 %), mais loin derrière les terminaux (écrans et téléviseurs) qui concentrent l’essentiel.
PUE, l’indicateur pionnier
À sa mise en place en 2007 par le Green Grid, un consortium mondial d’organisations privées et publiques, le PUE moyen était de 2,5. Il a rapidement décru pour se stabiliser à partir de 2014 dans une fourchette de 1,6 à 1,5. Dans sa 12e enquête, Uptime Institute, le seul organisme à délivrer des certifications de centre de données, rappelle que cette évolution reflète l’adoption généralisée de mesures peu coûteuses. L’institut international évoque la mise en place de systèmes de confinement des allées froides et allées chaudes. Dans ce système, l’air chaud évacué des équipements informatiques est collecté, refroidi et mis à disposition des entrées d’air. Le recours à l’air extérieur en hiver (free-cooling) en vue de couvrir les besoins en refroidissement s’est lui-aussi largement répandu.
Enfin, le pilotage du refroidissement a permis d’optimiser l’utilisation des ressources énergétiques. Avec ces progrès, les nouveaux datacenters atteindraient un PUE moyen de 1,3. Mais cet indicateur s’avère aujourd’hui insuffisant pour mesurer l’impact environnemental global d’un datacenter. « Le PUE n’est pas une mesure parfaite, mais sa simplicité a incité les exploitants à réduire leurs consommations énergétiques. Parallèlement, le secteur a vu émerger de nombreuses métriques plus ou moins pertinentes proposant d’aller au-delà du PUE. Dans ce contexte, Schneider Electric a estimé judicieux d’élaborer un guide des indicateurs de pérennité environnementale des datacenters à destination des exploitants qu’ils soient débutants, confirmés ou chevronnés. En effet, nous fournissons toute la chaîne de matériel électrique des centres de données (transformateurs, onduleurs, armoires de refroidissement, systèmes pilotage, etc.). Ce guide propose 23 indicateurs clés répartis dans cinq catégories : l’énergie, les émissions de gaz à effet de serre, l’eau, les déchets, ainsi que la terre et la biodiversité », détaille Damien Giroud, directeur des ventes Secure Power France, chez Schneider Electric.
Parmi ces indicateurs figure le WUE (water usage effectiveness) également créé par le Green Grid. Ce paramètre mesure le rapport entre la quantité d’eau consommée pour refroidir le datacenter et l’énergie consommée par l’infrastructure informatique. Il devrait monter en puissance ces prochaines années. En effet, les Néerlandais ont découvert l’été dernier en pleine canicule que le datacenter Microsoft situé au nord des Pays-Bas avait consommé 84 millions de litres en 2021. « Les solutions adiabatiques (rafraichissement par pulvérisation, Ndlr) sont consommatrices d’eau. En France, nous sommes moins concernés par cette problématique, car la plupart des datacenters fonctionnent sur des boucles d’eau fermées entre le groupe froid et l’armoire de climatisation », nuance Damien Giroud. Au-delà des techniques par refroidissement liquide ou à air, des pionniers explorent la technologie de refroidissement par immersion des serveurs dans une huile conçue à cet effet (immersion cooling), un système qui offrirait d’importants gains en kilowattheures.
Décarbonation des datacenters

L’utilisation d’indicateurs mesurant le recours aux énergies renouvelables apparaît comme un intéressant vecteur susceptible d’abaisser le CUE (carbon usage effectiveness) des datacenters, un autre indicateur du Green Grid mesurant les émissions annuelles de CO2. D’ailleurs, de plus en plus d’opérateurs cherchent à produire eux-mêmes leur énergie « verte » en adossant des panneaux photovoltaïques à leurs sites. Pour sa part, l’opérateur de télécommunications et de cloud Adista mettra en service en 2023, dans le secteur de Nancy, la première tranche d’un datacenter alimenté en électricité et en froid par méthanisation. Selon l’entreprise, qui a collaboré avec la start-up Datafarm Energy, cette installation devrait fournir 14 GWh par an et abaisser jusqu’à 90 % les émissions de gaz à effet de serre, par rapport à une alimentation électrique classique.
La valorisation des énergies de récupération est également un enjeu majeur, en droite ligne avec la réalisation des objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) en France qui invite à consommer moins et mieux. À Lille par exemple, la chaleur fatale du datacenter de CIV France (3 200 m²) est ainsi valorisée pour maintenir hors gel un entrepôt voisin, un besoin jusqu’alors assuré par deux chaudières au gaz. En retour, le centre de stockage de données profi tera d’une eau refroidie. Le même fonctionnement est appliqué depuis 2015 à son datacenter de Valenciennes (2 900 m²), mais en s’appuyant cette fois sur le réseau de chaleur urbain de l’agglomération.
Stratosfair, l’hébergeur écologique et local
Fondé en 2020, Stratosfair souhaite devenir le premier hébergeur de données écologique et local. À ces fins, la start-up bretonne a mis au point un petit datacenter duplicable, complémentaire des grands centres de données, car davantage destiné aux petites et moyennes entreprises. « Nous entrons dans l’aire de la décentralisation du numérique, c’est pourquoi nous espérons développer très vite notre modèle dans des déserts de datacenters que sont les régions de Brest, Rennes ou encore Nantes », insiste Bérenger Cadoret, fondateur de Stratosfair. La première installation mise en service en septembre dernier à Lanester (Morbihan) coche de nombreuses cases. Les seize baies informatiques ont été placées dans des conteneurs maritimes de seconde main posés sur des plots en béton, afin de limiter l’artificialisation des sols. Les salles informatiques bénéficient des méthodes modernes de refroidissement, avec des couloirs chaud/froid et l’utilisation de l’air extérieur (free cooling). « Et comme dans tout datacenter, nous sommes équipés d’un groupe électrogène au fioul, mais nous planifions son remplacement par une pile à combustible », poursuit le fondateur de Stratosfair. En vitesse de croisière, ses panneaux solaires (38 kW) devraient couvrir 25 % de la consommation énergétique, le reste de l’électricité étant fournie par des contrats avec des fournisseurs locaux d’énergies renouvelables. Enfin, le datacenter de Lanester devrait valoriser sa chaleur fatale dans une serre urbaine mise à disposition d’une association.
Zéro artificialisation des sols
Les initiatives vertueuses ne manquent pas, reste à les généraliser. Le français Qarnot a ainsi créé des serveurs d’un nouveau genre : la chaleur qui émane des modules informatiques développés pour le calcul intensif n’est pas rafraîchie par des climatiseurs, mais réutilisée dans la production d’eau chaude. La certifi cation ISO 50001 pour le management des énergies pousse dans cette direction en demandant aux hébergeurs d’étudier la possibilité de récupérer leur chaleur fatale. De même, depuis début 2022, les réductions de la taxe intérieure sur la consommation fi nale d’électricité (TICFE) dont bénéficie le secteur, sont aussi soumises à des éco-conditions.
L’objectif de zéro artificialisation nette des sols promu en France à l’horizon 2050 par la loi Climat et Résilience s’impose également au secteur. L’entreprise XL DataCenter a pris les devants en installant son centre de donnée XL360 à Toulon dans un ancien bâtiment militaire de la marine nationale. Ce recyclage du foncier existant aurait contribué à éviter 3 000 tonnes de CO2 par rapport à une construction neuve. « Ces exemples de réutilisation de friches urbaines ne sont pas anecdotiques. Toutefois, en raison des enjeux de temps de latence, les principaux opérateurs continueront de privilégier les grands noeuds télécom d’Europe du nord ou encore les environs de Marseille et de Bordeaux où se trouvent les câbles sous-marins », avertit la déléguée générale de France Datacenter.
Réemploi de supercalculateurs
Au-delà de la nécessité d’améliorer le bilan carbone des datacenters en recyclant les friches urbaines, mais aussi les matériaux informatiques, se pose la question du réemploi. « Les serveurs informatiques ont une durée de vie de six à huit ans, mais pour des questions de sûreté-sécurité les contrats imposent leur remplacement tous les trois ans. Il faut trouver des moyens de remettre ces équipements dans la chaîne de valeur ! », interpelle Bérenger Cadoret, cofondateur de la startup Stratosfair (lire page précédente).
Depuis 2020, Exaion, filiale d’EDF, donne pour sa part une seconde vie aux supercalculateurs du géant français de l’électricité, des ordinateurs dont les performances avoisinent au moment de leur conception la vitesse de fonctionnement la plus élevée existante. « Ils sont utilisés dans le cadre d’applications scientifiques et techniques et gèrent des bases de données gigantesques pour les prévisions météorologiques par exemple. Ils ont une durée de vie de trois ans en moyenne. Nous les récupérons, nous les réhabilitons et nous les remettons en circulation. Nous en avons fourni à l’Assistance publique Hôpitaux de Paris pour ses recherches sur le Covid-19 au début de la pandémie. Aujourd’hui nous mettons la puissance de calcul de nos quatre supercalculateurs à disposition des acteurs du métavers, la prochaine génération d’internet », détaille Fatih Balyeli, cofondateur d’Exaion.
Meilleur taux d’utilisation
Sébastien Cousin, président de CIV France regrette cependant que le champ d’action des centres de données demeure limité. En effet, 60 % des consommations électriques d’un datacenter proviennent en moyenne de l’alimentation des ordinateurs qui sont la propriété de ses clients, 30 % de la production de froid et 10 % d’usages divers. « Nous essayons de faire adhérer nos clients au concept de rendement digital, autrement dit à l’amélioration du taux d’utilisation de leurs processeurs, disques durs et mémoires vivres. En effet, cela n’a aucun sens de faire rouler un TGV sans passager ! Pas plus que de faire fonctionner un datacenter affichant un PUE de 1,1 avec des serveurs tournant à vide. C’est pourquoi, nous aimerions distinguer les entreprises qui acceptent de monitorer leur rendement digital. Dans le cadre de notre démarche ISO 50001, nous avons réussi à gagner 33 % de consommation énergétique sur nos propres serveurs de supervision. Si nos clients appliquaient cette mesure, nous atteindrions les objectifs du dispositif Eco énergie tertiaire pour 2030 », argumente Sébastien Cousin.
Chaque effort compte désormais alors que la crise énergétique touche tous les secteurs et que les experts estiment qu’il faudra multiplier par 1 000 les capacités de calcul informatique pour fournir des services métavers à l’horizon 2030…