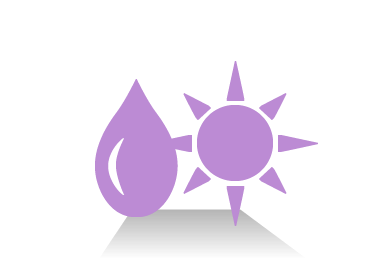L’avenir des groupes électrogènes passe par l’hydrogène
Pour remplacer les générateurs diesel bruyants et polluants, de plus en plus d’acteurs de la construction, du spectacle ou de la gestion de réseaux électriques commencent à se tourner vers des groupes électrogènes à hydrogène équipés de piles à combustible. Ce marché balbutiant doit encore se structurer mais entrevoit un potentiel considérable.
Lors du festival WeLoveGreen qui s’est tenu dans le bois de Vincennes du 2 au 5 juin, les spectateurs ont pu profiter de concerts alimentés par de l’électricité bas carbone. Traditionnellement, les événements éphémères qui ne peuvent pas se relier au réseau électrique ont pris l’habitude de recourir à des groupes électrogènes brulant du diesel. Cette solution polluante et bruyante a été abandonnée par les organisateurs au profit de panneaux photovoltaïques associés à des batteries, de générateurs alimentés par de biocarburants composés à 100 % de colza français ou par de l’hydrogène issu d’électrolyse. Les effets de lumières et la sonorisation du festival de musique étaient donc assurés par un générateur équipé d’une pile à combustible (PAC) de 20 kW. Avec, à la clé, un meilleur bilan carbone et moins de bruit autour des scènes.
Ces générateurs se développent aussi sur d’autres marchés. « En France, outre l’évènementiel, le bâtiment est un débouché important. Une de nos machines est également en test chez Enedis pour alimenter les usagers lors des travaux de maintenance sur le réseau électrique », explique Thibault Tallieu, directeur Marketing et Communication chez EODev. Cette technologie peut aussi servir de solution de secours pour pallier aux défaillances des réseaux. Aux États-Unis notamment, où ils sont souvent vétustes, elle peut être utilisée dans ce but. D’autant plus que lors des fortes chaleurs, les exploitants coupent parfois le courant pour éviter des incendies dans les transformateurs. Ces équipements peuvent également remplacer le diesel dans des systèmes de secours pour les hôpitaux, les gendarmeries, les casernes de pompiers, les datacenters ou le secteur de l’alimentaire pour la réfrigération.
Mais ces applications ne semblent pas forcément adaptées à un pays comme la France où le réseau est stable, les coupures rares, et où les solutions de backup ne tournent que quelques heures par an. Dans ces conditions, la pollution émise par un générateur diesel reste assez limitée. Enfin, les générateurs à hydrogène présentent un intérêt pour les sites qui ne sont pas du tout reliés au réseau comme des refuges en montagne. Un système exploité par EDF Systèmes énergétiques insulaires est par exemple installé dans le cirque de Mafate, sur l’île de la Réunion.
Un contexte favorable
Les premières entreprises se sont positionnées sur le secteur dès 2016. Depuis, le contexte est devenu de plus en plus favorable à son essor. « En 2018, un plan de 100 millions d’euros a été mis en oeuvre par le Gouvernement pour développer la filière hydrogène. En 2020, un second plan de 7,2 milliards a été annoncé. Cela a créé un engouement autour de l’hydrogène et a incité de nouveaux acteurs à s’intéresser notamment aux piles à combustible », relate Rémi Courbun, chargé de mission chez France Hydrogène. Dans le même temps, la législation a évolué pour réduire les émissions de polluants dans les zones urbaines.
Des zones à faibles émissions (ZFE) ont été créées dans le cadre de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 et figurent dans le projet de loi d’orientation des mobilités (Lom). Les véhicules les plus polluants ne peuvent pas y accéder. « Politiquement, il va être compliqué d’expliquer aux automobilistes qu’ils ne peuvent plus venir en centre-ville tout en maintenant des groupes diesel polluants sur les chantiers de construction par exemple », estime Jean-Emmanuel Boucher, directeur commercial chez Powidian. Cela incite les entreprises à s’équiper en générateurs décarbonés, d’autant plus qu’elles mettent en œuvre des politiques pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Bouygues ou Vinci ont désormais des ambitions de décarbonation de l’ordre de 30 à 40 % : les groupes électrogènes à hydrogène sont un des leviers disponibles pour atteindre ces objectifs.
La réglementation se renforce aussi sur les émissions des groupes électrogènes. La norme européenne Stage V, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, a pour objectif de préserver l’environnement et la santé des consommateurs en agissant directement à la source des émissions de polluants. Elle définit une série de contraintes à destination des constructeurs de moteurs diesel. Les rejets de monoxyde d’azote doivent rester inférieurs à 400 mg/kWh et ceux de particules ne doivent pas dépasser 15 mg/kWh. Le précédent seuil était fixé à 25 mg/kWh. Ces équipements deviennent donc de plus en plus chers à l’achat, ce qui, conjugué à la hausse des prix des carburants, incite de moins en moins à s’en équiper. Outre ces réglementations défavorables au diesel, la plus grande disponibilité de l’hydrogène issu de l’électrolyse va dans le sens d’un essor des générateurs à PAC. La France a un objectif de production de 6 GW en 2030 et l’Europe espère atteindre 40 GW à cette échéance.
La France bien placée sur le marché
La France est particulièrement bien placée sur ce marché encore émergent. Powidian a été créée en 2014 et commercialise deux modèles fabriqués à partir d’équipements déjà existants (PAC, batteries, etc.). Le moins puissant développe 4 kW. Il est destiné à alimenter quelques équipements sur un chantier (rechargement d’une pelleteuse, d’une chargeuse, etc.). L’autre, d’une capacité de 100 kva, peut de son côté alimenter un chantier entier. « Nous travaillons avec Ballard qui est le fournisseur n°1 de PAC dans le monde et qui nous assure des durées de vie importantes car celles-ci sont installées à la base dans des bus à hydrogène », précise Jean-Emmanuel Boucher. Powidian a comme clients Bouygues Telecom et Enedis. Le gestionnaire de réseau utilise un groupe électrogène fourni par le groupe pour alimenter des habitants lorsque des travaux de maintenance sont réalisés sur les lignes électriques. Des expériences ont notamment été menées dans le Cher et dans l’Indre. Mais Enedis utilise aussi des appareils de la concurrence, en particulier d’EoDev.
L’entreprise est issue du projet Energy Observer. « Le système de pile à combustible développé à bord du bateau peut être adapté à un usage stationnaire. C’est sur ce postulat que notre entreprise a été créée en 2019 », raconte Thibault Tallieu, directeur marketing et communication chez EODev. La société a déjà construit vingt unités de son GEH2 dans son usine de Montlhéry, en Essonne. Les premières ont été livrées en décembre dernier surtout à l’export vers l’Europe, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Australie. « Actuellement, nous mettons en place une véritable chaine de production en série qui fabriquera une vingtaine d’appareils chaque mois », détaille Thibault Tallieu. Elle pourra passer à cinquante unités si la demande se renforce. Les PAC sont fournies par Toyota. C’est la même que celle utilisée dans le modèle Mirai. H2SYS, Helion, HDF Energy, H2X sont les autres constructeurs français qui occupent le marché. Ces startups qui font office de pionnières restent encore un peu seules sur ce créneau mais elles ne devraient pas l’être très longtemps. Les grands fabricants de générateurs et de moteurs commencent à s’intéresser à cette solution car ils vont devoir trouver des alternatives au diesel. General Motors s’est lancé cette année : des premières applications sont prévues auprès de l’armée américaine et de la mission de développement économique du Michigan. Ses générateurs sont installés sur des remorques pour des besoins ponctuels.
La filière doit se structurer
Si les acteurs sont de plus en plus nombreux à se positionner sur cette technologie, le marché doit encore se structurer. Il devra tout d’abord faire baisser ses coûts. « Les groupes à hydrogène sont quatre fois plus chers que les plus perfectionnés fonctionnant au diesel. Sur dix ans, plus les machines fonctionnent plus elles sont pertinentes économiquement. Il est possible de croiser les courbes selon les usages au bout de cinq ou six ans notamment à cause de la hausse des prix des hydrocarbures », estime Thibault Tallieu. Pour Jean-Emmanuel Boucher, le coût n’est pas vraiment un problème : « Les clients sont prêts à payer la différence car cela leur permet de répondre à leurs engagements RSE ». Les constructeurs devront également étoffer leurs gammes pour répondre à un maximum d’applications. Certains y pensent déjà. « Nous l’envisageons dans les années à venir. Pour autant, il n’y aura pas de gammes aussi variées que ce qui existe pour le diesel car il y a moins de variété de puissance disponible sur les PAC que sur les moteurs », révèle le directeur commercial de Powidian. Cela ne posera pas forcément de problème car un système de PAC avec batteries permet de couvrir un large éventail de puissances sans détériorer son rendement contrairement aux générateurs classiques. De plus, il est possible d’en associer plusieurs pour atteindre des puissances plus importantes.
Adapter la réglementation semble être un enjeu plus important. Comme l’utilisation de ces générateurs est assez nouvelle, ils font face à des règles qui ne sont pas toujours adaptées. Il y a notamment des réglementations spécifiques sur le stockage d’H2 dans l’ICPE n°4715. En effet, les générateurs nécessitent des dispositifs de stockage temporaires. Mais la réglementation est la même que pour les stockages pérennes. « Les utilisateurs sont notamment censés déclarer trois mois à l’avance un dispositif de stockage, donner sa localisation exacte et déclarer un mois à l’avance la fin de son utilisation. Pour un usage sur un chantier ou en backup de quelques jours, ces démarches sont impossibles à mener à bien car il faudrait déclarer la cessation d’activité avant même son début », regrette Rémi Courbun. France Hydrogène travaille donc avec les acteurs de la filière, l’Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) et la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) afin de déterminer comment adapter la réglementation pour ces usages temporaires qui sont amenés à se multiplier. Le marché, évalué à 1,13 milliards de dollars cette année, devrait doubler d’ici cinq ans.
Des générateurs H2 sans PAC
Certains constructeurs misent plutôt sur des générateurs qui fonctionnent grâce à des moteurs à combustion interne avec une turbine qui utilise directement de l’hydrogène en intrant sans passer par une pile à combustible, parfois en mélange avec du gaz naturel. Cela permet d’émettre moins de CO2 (voire pas du tout si le moteur ne brule que de l’H2). Toutefois, le moteur reste un moteur thermique et émet tout de même des oxydes d’azote (Nox). Cette technologie est beaucoup plus ancienne que les PAC. Caterpillar y travaille depuis 35 ans. Cette solution pourra répondre à certains besoins qui ne conviennent pas aux PAC. La plupart de ses générateurs ont la capacité de fonctionner avec des mélanges d’hydrogène de 5 à 10 %. Certains équipements personnalisés pour des clients comptent plus de 200 000 heures de fonctionnement avec un mélange d’hydrogène pouvant atteindre 60 %. Des tests sont actuellement en cours pour bruler 100 % d’hydrogène dans certains modèles du constructeur américain. C’est aussi l’objectif de l’industriel BEHydro, joint-venture entre ABC et CMB, qui a fait fonctionner en 2020 un moteur de 1 MW alimenté à 100 % par de l’H2. L’entreprise belge envisage de le commercialiser à la fois pour mouvoir des bateaux, des trains, ou pour générer des électrons. Volvo et Man travaillent actuellement sur des moteurs thermiques à hydrogène qui seraient installés dans des poids-lourds. Les véhicules pourraient être commercialisés entre 2023 et 2024. Une fois cette technologie au point, on peut imaginer qu’elle se retrouvera sur le marché des générateurs comme cela s’est passé pour les PAC, d’abord développées pour la mobilité puis utilisées pour produire de l’électricité.