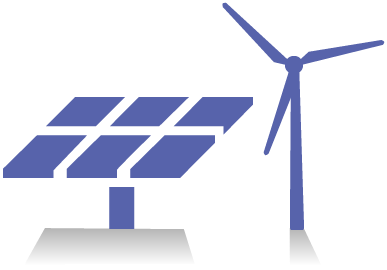Précarité énergétique : un accompagnement social, technique et financier indispensable
 Gerhard Seybert / Adobe Stock
Gerhard Seybert / Adobe StockDans le contexte actuel de hausse des prix de l’énergie, le nombre de ménages touchés par la précarité énergétique risque d’exploser. Pour lutter contre ce phénomène, un accompagnement poussé de ce public fragile est primordial afin de favoriser la rénovation énergétique et performante des logements.
Il y a à peine trois mois, l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) se fendait d’une déclaration collective appelant à faire de sa spécialité une priorité nationale. Un trop grand nombre de foyers sont encore confrontés à ce phénomène, malgré les dispositifs lancés et les démarches menées. Les chiffres restent éloquents. D’après les indicateurs tirés de l’ONPE, 5,6 millions de ménages seraient en précarité énergétique en France en 2021. Cela correspond à plus de 20 % des ménages, soit 12 millions de personnes qui n’ont pas les moyens de chauffer leur logement correctement.
La situation paraît par ailleurs de plus en plus préoccupante. « L’augmentation très importante du prix de l’électricité, comme celui du gaz, depuis la crise sanitaire vient contrebalancer, voire inverser, la dynamique qui allait vers une réduction du nombre de précaires en France. On s’oriente malheureusement vers une explosion de ce nombre », déplore Florence Lievyn, responsable des affaires publiques et des programmes chez Sonergia. Selon le baromètre annuel du Médiateur national de l’énergie publié en novembre dernier, 20 % des Français déclarent avoir souffert du froid au cours de l’hiver 2021, pendant au moins 24 heures. C’est six points de plus par rapport à l’an dernier. Environ 60 % des Français ont également restreint le chauffage chez eux pour ne pas avoir des factures d’énergie trop élevées et 25 % ont éprouvé des difficultés à les payer (contre respectivement 53 % et 18 % pour l’hiver 2020).
Bilan des politiques publiques
Ces quelques chiffres montrent que « les indicateurs sont à la hausse, tout comme le nombre de personnes en situation de précarité énergétique », indique Aurélien Breuil, responsable de projet à Solibri et animateur du Réseau des acteurs de la pauvreté et de la précarité énergétique dans le logement (Rappel). Et de rajouter que l’impact des politiques publiques reste relativement faible comme l’a souligné l’ONPE dans une récente étude. Celle-ci dresse le bilan des actions de dix ans de lutte contre la précarité énergétique en France, et révèle que les dispositifs mis en place ne sont pas assez lisibles et accessibles pour les ménages concernés.
De plus, elle pointe le manque de moyens et de suivi des politiques sur les effets de la réduction de la précarité énergétique. « Sans ces actions, la précarité énergétique aurait forcément eu un niveau supérieur, mais ces données nous amènent à douter de la manière dont ont été conçues les politiques publiques. La précarité énergétique est souvent une variable de la rénovation énergétique. Jamais elle n’est prise en compte pour elle même avec des solutions réellement construites autour de cet enjeu. Cela n’a donc que des effets marginaux sur le phénomène », avance Danyel Dubreuil, responsable de l’initiative « Rénovons ! ».
Suite à ces conclusions, l’ONPE et ses 28 membres ont émis plusieurs recommandations à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration d’un futur plan national de lutte contre la précarité énergétique. Il comprend notamment le renforcement des aides au paiement des factures, la garantie d’un reste à charge zéro pour les ménages très modestes voulant se lancer dans des travaux de rénovation performante, sans oublier la nécessité de guider les ménages les plus démunis et donc de former ces accompagnateurs.
Identifier et accompagner
Quels que soient les acteurs impliqués, tous s’accordent sur la nécessité de guider les ménages très modestes pour lutter contre la précarité énergétique. Souhaité tout au long du parcours de rénovation performante, cet accompagnement est primordial pour de nombreuses raisons : embarquer et rassurer le ménage, créer une dynamique, participer à l’élaboration de solutions techniques adaptées, trouver les financements accessibles dans le maquis d’aides existantes ou encore assurer un suivi du chantier jusqu’à sa livraison.
« À chaque étape d’un long chantier de rénovation globale, il y a une possibilité de découragement du ménage et d’arrêt des travaux, d’où l’importance de l’accompagnement. Il y a tout un enjeu autour des moyens humains et leurs financements pour renforcer les tiers de confiance », précise Claire Bally, responsable de projets précarité énergétique au Cler et également animatrice du réseau Rappel. Depuis 2013, le Cler porte ainsi le programme Slime qui a pour ambition de massifier le repérage, l’orientation et l’accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique, et quel que soit leur statut d’occupation.

L’action est portée par une collectivité qui va coordonner le rôle des acteurs, notamment les donneurs d’alerte comme les aides à domicile et les travailleurs sociaux. Quarante-six collectivités se sont engagées et plus de 52 000 ménages ont été accompagnés. « Notre volonté pour cette nouvelle période du dispositif des certificats d’économie d’énergies (CEE) est de doubler ces chiffres, soit 100 collectivités et 100 000 ménages accompagnés », espère Claire Bally.
Dans le « Scénario 2030, ensemble éradiquons la précarité énergétique en France » de l’association Stop à l’exclusion énergétique, cette notion d’accompagnement apparaît également comme centrale, sous le nom d’« ensembliers solidaires ». Ces derniers ont vocation à accompagner socialement, techniquement, financièrement de bout en bout les familles en grande précarité dans leurs travaux de rénovation. « Les ensembliers solidaires interviennent à la fois en tant que tiers de confiance pour les familles, coordinateurs techniques pour les travaux, et coordinateurs sociaux et financiers pour l’obtention des aides », détaille Gilles Berhault, fondateur du collectif.
Un essai à grande échelle de formations d’ensembliers solidaires va être lancé dans plusieurs territoires (Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Occitanie, Hauts-de-France). « Cette expérimentation nous permet de créer et tester les formations dispensées, et de définir en fonction des premiers retours les futurs porteurs de ces formations. L’objectif est de parvenir au nombre de 20 000 formés d’ici 2030 », avance Gilles Berhault.
Mon Accompagnateur Rénov’
Le lancement du nouveau service France Rénov’ le 1er janvier dernier est également une réponse à ce besoin d’accompagnement des ménages et de simplification de leurs parcours de rénovation énergétique, y compris les ménages modestes et grands précaires. Ce guichet unique regroupe les espaces conseils « Faire » et les points rénovation information service (Pris) de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Soit plus de 450 structures réparties sur l’ensemble du territoire et désormais appelées Espaces Conseil France Renov’.
Outre de meilleures informations sur les aides financières disponibles et sur la qualité des artisans, les ménages seront surtout éligibles à Mon Accompagnateur Rénov’. « Le rôle de ce tiers de confiance sera de guider les ménages de bout en bout de leur parcours de travaux, mais également d’assurer un accompagnement spécifique auprès des ménages en situation de précarité énergétique », indique le ministère de la Transition écologique.

Sur le papier ce service paraît pertinent, mais certains acteurs émettent toutefois quelques doutes. Si, en 2022, Mon Accompagnateur Rénov’ s’appuiera sur le réseau des opérateurs de l’Anah et des nouveaux espaces conseil France Renov’, il est prévu qu’il s’étende dès 2023 aux acteurs privés (architectes, bureaux d’études, fournisseur d’énergies, délégataires…) afin de rendre plus accessible cet accompagnement et massifier la rénovation performante des logements. Un décret, actuellement en cours de consultation, devrait préciser les conditions d’agrément pour assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés.
Mais quelles sont les garanties assurant que l’interlocuteur privé agréé restera vraiment impartial, sachant qu’il pourrait être juge et partie ? « Mon accompagnateur Rénov’ vise à ouvrir aux privés l’accompagnement des ménages, donc en tant qu’association, on peut émettre de sérieux doutes sur les réelles intentions de cet outil », estime Danyel Dubreuil.
Pour Aurélien Breuil de Solibri, ce nouvel outil suscite beaucoup d’interrogations. « Il n’y a par exemple toujours pas d’élément incitant ces interlocuteurs à se tourner préférentiellement vers les plus précaires. Les modalités de financement de cet accompagnement, qui devrait être en grande partie assuré par les CEE, n’ont également toujours pas été précisées. Enfin, les futurs accompagnateurs agréés, tels que des bureaux d’études ou des architectes, seront-ils en mesure de bien d’orienter les ménages très modestes, sachant qu’ils n’ont pas l’habitude de travailler avec un tel public ? », questionne-t-il. Le travail auprès de personnes précaires reste en effet une démarche au cas par cas qui nécessite de définir un parcours d’orientation le plus adapté aux problèmes rencontrés, la précarité énergétique s’accompagnant souvent d’une fracture sociale ou numérique.
Minimiser le reste à charge
La dimension d’accompagnement des foyers modestes et précaires est également fondamentale pour aider au bouclage du plan de financement d’opérations de rénovation performante dont le prix avoisine les 30 000 à 40 000 euros. « La grosse problématique rencontrée par les ménages est le maquis d’aides, avec une vingtaine de mécanismes nationaux qui viennent financer la rénovation énergétique, sans compter la multitude d’aides locales. Il est difficile de s’y retrouver seul », relève Claire Bally.
« Cela reste une chance, et souligne l’importance du rôle de Mon accompagnateur Rénov’ qui devra composer avec les différentes aides. Trois à quatre au minimum par projet », poursuit Michel Pelenc, directeur général de la Fédération solidaire pour l’habitat (Soliha). En remplacement du programme Habiter Mieux, le dispositif MaPrimeRénov’ Sérénité est la principale aide s’adressant spécifiquement aux ménages aux revenus modestes et très modestes. Il permet désormais une prise en charge allant jusqu’à 50 % des travaux réalisés, plafonnés à 30 000 euros, et cumulables avec des primes octroyées par les collectivités locales. À partir du 1er juillet 2022, il sera possible de bénéficier également des primes CEE ou de la prime Coup de pouce rénovation performante
Toutes ces aides cumulées financent au mieux 80 à 85 % du montant total des travaux. « Mais pour les plus précaires, le reste à charge s’élevant à plusieurs milliers d’euros est un élément rédhibitoire au passage à l’acte », juge Florence Lievyn. Plusieurs offres bancaires ont été développées pour soutenir les ménages, comme le prêt ÉcoPTZ. Le plafond de celui-ci a été rehaussé de 30 000 à 50 000 euros, avec des mensualités désormais étalées sur vingt ans au lieu de quinze. Il existe aussi l’éco-prêt Habiter Mieux qui est toutefois très peu distribué. Proposé seulement par le Crédit agricole, ce dernier intervient pour le financement du reste à charge ou le préfinancement des subventions versées par l’Anah, dans la limite de 20 000 euros. « Un éco-prêt reste un prêt et aura des incidences sur le pouvoir d’achat d’un foyer. Les grands précaires sont-ils décidés à prendre un emprunt sur vingt ans quand, dans le même temps, ils ne savent pas comment payer des factures de la vie courante ? », pointe la responsable de Sonergia.
Un autre produit bancaire, déjà testé dans le passé, fait son retour en 2022 : le prêt avance rénovation. Il s’agit d’un prêt hypothécaire qui permet de reporter le remboursement du reste à charge des travaux (après versement des subventions) lors de la vente du logement ou lors d’une succession. Les intérêts du prêt peuvent quant à eux être remboursés au fil de l’eau pendant la phase où le bien est occupé, ou in fine. « Ce prêt garanti par l’État à 75 % permet de s’adresser aux ménages précaires qui sont exclus du circuit bancaire classique. Seul souci, il n’y a que la Banque postale et le Crédit mutuel qui se sont engagés à le proposer… Il faut désormais que le secteur bancaire joue vraiment le jeu ! », appuie Aurélien Breuil.
Des expérimentations de tiers financements portés par des entreprises privées vont être lancées, où les économies d’énergie financeront les travaux. Le ménage n’a donc pas à débourser de sommes aussi conséquentes, ce qui est intéressant. Enfin, certains organismes comme le Secours Catholique et Stop à l’exclusion énergétique versent des aides supplémentaires, obtenues par des appels aux dons.
Beaucoup d’acteurs, au premier rang l’ONPE et ses membres, souhaitent la mise en place d’une garantie d’un reste à charge zéro pour les ménages très modestes voulant se lancer dans des travaux de rénovation. « Notre revendication porte sur une couverture à 100 % et déplafonnée du financement des ménages les plus modestes pour leurs besoins de rénovation. Et vu le nombre de ménages pour les trois premiers déciles, c’est tout à fait raisonnable en termes de finance publique. Les bénéfices engendrés par l’État et la société dans son ensemble seront de toute façon plus importants que l’aide financière apportée », conclut le responsable de « Rénovons ! ».