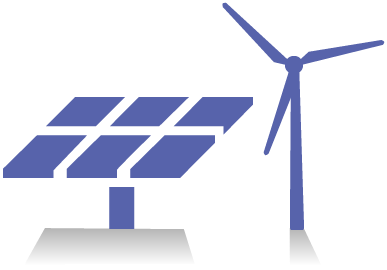« La crise ukrainienne pourrait accélérer les EnR européennes », estime Emmanuel Grand
L’invasion de l’Ukraine par la Russie se poursuit déstabilisant toujours plus les marchés de l’énergie. Emmanuel Grand, économiste spécialisé dans le secteur de l’énergie du cabinet de conseil FTI Consulting, revient pour Énergie Plus sur les conséquences de cette guerre, qui pourrait permettre à l’Europe de déployer plus rapidement le renouvelable, avec potentiellement plus de difficultés.
Quel est le contexte actuel du marché du gaz en Europe, en particulier depuis l’invasion russe de l’Ukraine ?
Emmanuel Grand : Je pense qu’on ne peut pas faire l’économie de regarder ce qui s’est passé en 2021 pour comprendre le marché et le niveau des prix aujourd’hui. Il y a eu l’année dernière une reprise de la demande importante en Asie, avec un fort dynamisme de la demande chinoise, et un retour aux consommations pré-pandémique en Europe et aux États-Unis. Alors que le prix du gaz n’avait jamais atteint 40 € du mégawattheure depuis 15 ans, cela fait six mois qu’il évolue entre environ 80 et 200 €/MWh.
Aujourd’hui, le gaz russe continue de couler vers l’Europe, mais l’anticipation d’une coupure potentielle pèse sur le marché. Il y a une forme de spéculation qui se met en place car avoir du gaz maintenant et le mettre en stock semble plus sûr que d’attendre une livraison dans quelques mois. Parallèlement, le projet européen REPowerEU vise à réduire drastiquement la dépendance du continent au gaz russe. Or, la Russie est l’un des plus gros producteurs mondiaux de gaz, et la majorité de ses exports sont envoyés à l’Europe par gazoducs. S’il n’a plus de débouchés au bout du gazoduc, ce gaz russe ne va pas pouvoir trouver rapidement d’autre client, il ne sera donc pas exploité à son plein potentiel. Cela risque de retirer une offre importante du marché mondial entraînant un déséquilibre et une montée des prix.
D’après la Commission européenne, la mise en oeuvre du plan REPowerEU permettrait de réduire de près des deux tiers le volume de gaz importé de Russie dans un délai d’un an. Pensez-vous cet objectif ambitieux réaliste ?
E. G. : D’après une étude réalisée par FTI Consulting, nous arrivons, avec les mêmes leviers, à réduire la dépendance européenne des deux tiers à court terme. Et à plus longue échéance, d’ici à 2025, il est possible de se passer quasiment entièrement du gaz russe. Cependant, atteindre ces niveaux d’indépendance nécessite des mouvements très forts et coûteux.
On parle tout de même de redémarrer des centrales à charbon en Europe, de prolonger l’existence du nucléaire, de demander aux ménages de baisser leur chauffage, ou encore de réduire l’activité industrielle avec des effets sur la création de valeur mais aussi sur les emplois. Si nous confirmons avec cette étude la possibilité d’atteindre ces économies de gaz, il y a de vraies questions sur la réalisation de cette ambition qui va demander de grands efforts aux gouvernements et aux populations. La question de la durée est aussi à prendre en compte.
L’indépendance européenne face au gaz russe est-elle donc incompatible avec les objectifs de réduction de gaz à effets de serre comme « Fit for 55 » ?
E. G. : Nous sommes dans une situation difficile où il faut entre deux mauvaises solutions — une dépendance russe ou un retour potentiel aux énergies carbonées — choisir la moins délétère. Le projet REPowerEU met l’accent sur les solutions de moyen terme, avec plus de biogaz, d’hydrogène, de solaire et d’éolien. Mais ce sont des technologies qui mettent du temps à être déployées. À plus courte échéance, on risque de recourir à des solutions plus carbonées, par rapport à une trajectoire où l’invasion russe n’aurait pas eu lieu.
D’un autre côté, la crise ukrainienne pourrait permettre à l’Europe d’atteindre plus rapidement des objectifs de production d’électricité et de gaz verts, mais à plus haut coût du fait de moindres effets d’apprentissage, et donc moins efficacement. Il y a également des volontés fortes de massifier le développement des renouvelables, en simplifiant notamment des démarches administratives, que ce soit les autorisations, les droits d’usage ou la gestion de contentieux. Ces évolutions seront fondamentales pour pouvoir déployer rapidement ces technologies dans des pays, comme la France, où les délais entre décision et réalisation peuvent être très longs, en particulier dans le cas de l’éolien en mer.